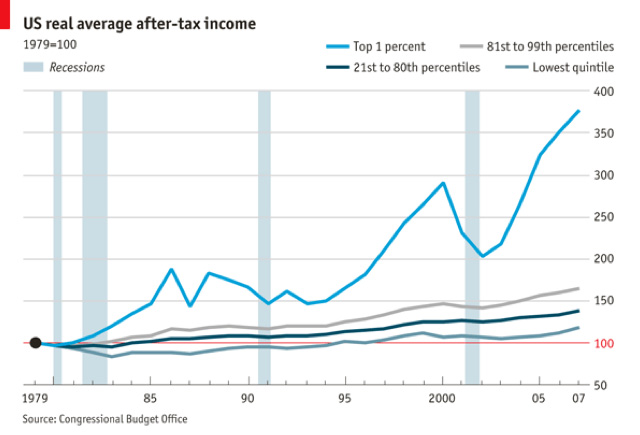François Chesnais
Par François Chesnais
La crise financière européenne est la manifestation dans
la sphère de la finance de la situation de semi-paralysie dans laquelle
se trouve l’économie capitaliste mondiale. Elle en est en ce moment la
manifestation la plus voyante, mais en aucune manière la seule. Les
politiques d’austérité menées simultanément dans la plupart des pays de
l’Union européenne (UE) contribuent à la spirale récessionniste
mondiale. Elles n’en sont pas l’unique cause. Les têtes de chapitre de
la note de perspective de l’OCDE de septembre 2011 étaient éloquentes: «L’activité mondiale est proche de la stagnation»; «Le commerce mondial s’est contracté, les déséquilibres mondiaux persistent»; « Sur le marché du travail, les améliorations sont de moins en moins perceptibles»; «La confiance s’est dégradée», etc. A
la suite des projections d’Eurostat à la mi-novembre d’une contraction
économique de l’UE, à laquelle même l’Allemagne ne fait pas exception,
la toute dernière note de l’OCDE (28 novembre 2011) fait état d’une «détérioration considérable» avec une croissance pour l’ensemble de l’OCDE de 1,6% et de 3,4% pour l’économie mondiale.
En
Europe, l’attention des travailleurs et des jeunes se concentre, de
façon compréhensible, sur les conséquences de la «fin de parcours» et du
«sauve-qui-peut» des bourgeoisies européennes. La crise politique de
l’Union européenne et de la zone euro et la valse-hésitation de la
Banque centrale européenne (BCE) autour du financement direct des pays
les plus en difficulté sont les expressions les plus voyantes. Leur
pendant est l’accentuation des politiques d’austérité et la mise en
place accélérée d’un «tout-sécuritaire» auquel aucun pays n’échappe.
Pourtant, la situation européenne ne peut pas être comprise
indépendamment de celle de l’économie mondiale prise comme un tout. La
CNUCED écrit au tout début de son rapport que «
le degré d’intégration et d’interdépendance économiques dans le monde aujourd’hui est sans précédent» [1]
. C’est
là un progrès intellectuel indéniable, dont beaucoup de commentateurs
et même de militants de gauche pourraient utilement s’inspirer. Le
champ de la crise est celui du «
marché mondial constitué»,
dont Marx parle très tôt dans ses écrits économiques [2]. Aujourd’hui,
depuis la réintégration de la Chine et la pleine incorporation de
l’Inde dans l’économie capitaliste mondiale, le marché mondial connaît
un degré dans la densité des relations d’interconnexion et la rapidité
des interactions jamais connu auparavant. C’est dans ce cadre que les
questions les plus essentielles – suraccumulation et surproduction,
surpuissance des institutions financières, concurrence intercapitaliste –
doivent être abordées.
Aucune «fin de crise» n’est en vue
Dans le langage économique courant d’inspiration keynésienne, la
formule «sortie de crise» désigne le moment où l’investissement et
l’emploi reprennent. En termes marxistes, c’est le moment où la
production de valeur et de plus-value, moyennant l’embauche et la mise
au travail de salariés, et la vente de marchandises permettant de
réaliser leur appropriation par le capital reposent de nouveau sur une
accumulation de moyens en équipement nouveaux, la création de nouvelles
capacités de production. Très rares sont les économies qui sont
insérées dans des rapports d’interdépendance mais qui continuent, comme
la Chine, à jouir d’une certaine autonomie et où la sortie de crise
est concevable au niveau de l’économie de l’Etat-nation. Toutes les
autres sont insérées dans des relations d’interdépendance dans
lesquelles le bouclage du cycle du capital – A-M-P-M’-A’ – d’une grande
partie des entreprises, en tous les cas toutes les grandes, se fait à
l’étranger; les plus grands groupes délocalisant carrément le cycle
entier d’une partie de leurs filiales.
C’est ce qui constitue la portée de l’impasse enregistrée lors du
dernier G20 (Cannes, novembre 2011). Plus de quatre après le début de
la crise (août 2007) et plus de trois ans après les convulsions
provoquées par la faillite de la banque Lehman Brothers (septembre
2008), la situation d’ensemble est marquée par l’incapacité du
«capital» – les gouvernements, les Banques centrales, le FMI et les
centres privés de centralisation et de pouvoir du capital pris
collectivement – de trouver, pour l’instant au moins, les moyens de
créer une dynamique du type indiqué au niveau de l’économie mondiale, ou
au moins de très larges pans de celle-ci. La crise de la zone euro et
ses impacts sur un système financier opaque et vulnérable en sont l’une
des expressions. Cette incapacité n’est pas synonyme de passivité
politique. Elle signifie simplement que l’action de la bourgeoisie est
mue de plus en plus complètement par la seule volonté de préservation de
la domination de classe dans toute sa nudité. Pour ce qui concerne de
façon immédiate et directe les travailleurs et travailleuses en Europe,
les centres de décision capitalistes sont activement à la recherche de
solutions qui protégeraient les banques, qui éviteraient le choc
financier de grande ampleur représenté par le défaut de paiement de
l’Italie ou de l’Espagne et l’effondrement de l’euro, et qui feraient
plus que jamais tomber tout le poids de la crise sur les classes
populaires. En témoigne l’arrivée à la tête des gouvernements grec et
italien, à quelques jours d’intervalle, de commis du capital financier
nommés directement par lui, moyennent des «entorses aux procédures
démocratiques». En témoignent surtout les différentes moutures d’un
projet de «gouvernance» autoritaire en discussion au sein de la zone
euro. Ce projet a des implications politiques d’autant plus graves pour
les travailleurs qu’il va de pair avec un durcissement du caractère
pro-cyclique des politiques d’austérité et de privatisation, et
contribue à la nouvelle récession qui est en marche.
De l’autre côté de l’Atlantique Nord, les appels incessants aux
dirigeants européens de Barack Obama ou du secrétaire d’Etat au Trésor,
Tim Geithner, pour qu’ils donnent une réponse politique à la crise de
l’euro au plus vite, traduisent le fait que «le moteur américain»,
comme le disent les journalistes, est «en panne». Le fonctionnement
macroéconomique étatsunien a été construit à peu près entièrement depuis
1998 (choc en retour de la crise asiatique) sur l’endettement
contraint des ménages, des PME et des collectivités locales. Ce «régime
de croissance» est profondément ancré. Il a renforcé si fortement le
jeu des mécanismes de répartition inégale des revenus (le mot d’ordre
d’Occupy Wall Street (OWS), «nous sommes les 99%», traduit l’écart béant
entre les très, très hauts revenus et ceux du reste des Américains)
que la seule perspective à laquelle les dirigeants s’accrochent
vraiment est celle du moment – lointain – où les gens pourront, ou
devront absolument, s’endetter à nouveau. Les différends
«inconciliables» entre Démocrates et Républicains portent sur deux
questions interconnectées: comment assurer le désendettement de l’Etat
fédéral, au mieux dans cette perspective? et celui-ci peut-il et
doit-il même s’endetter davantage ou non pour atteindre cet objectif?
Cette incapacité de concevoir tout autre «régime de croissance» traduit
la force économique et politique presque inentamée de la finance et de
l’oligarchie politico-financière des 1% (voir graphique sur
l’évolution des revenus aux Etats-Unis qui met en relief la croissance
de l’accaparement par le 1%; source:
The Economist, 26 octobre
2011; Congressional Budget Office). Le mouvement OWS est un premier
signe de craquement de cette domination, mais tant qu’un séisme mondial
incluant les Etats-Unis ne se sera pas produit la politique économique
américaine se réduit aux injections d’argent par la Banque centrale
(la Fed), en un mot au fonctionnement de la planche à billets, sans que
quiconque sache jusqu’à quand cela pourra durer.
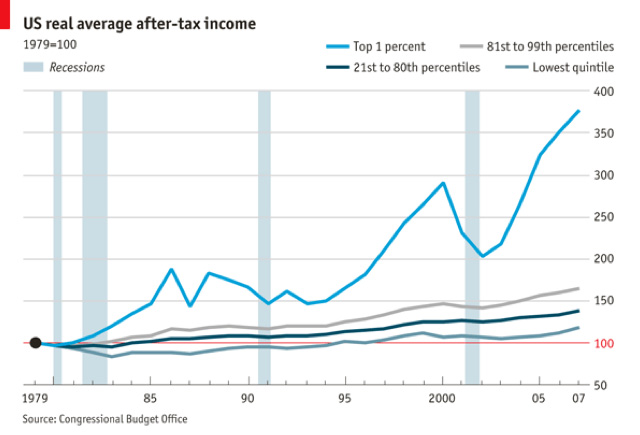
La Chine et l’Inde peuvent aider, comme elles l’ont fait en 2009, à
limiter la contraction de la production et du commerce. La Chine en
particulier continuera, mais avec plus de mal qu’avant, à établir un
plancher à la contraction mondiale. C’est de la pleine intégration de
l’Inde et de la Chine dans l’économie mondiale qu’est venu le saut
qualitatif dans la dimension de l’armée industrielle de réserve à la
disposition du capitalisme mondial pris comme un tout. De façon
complémentaire, c’est en Chine que se trouvent certains des plus
importants foyers de suraccumulation et de surproduction. On fait
beaucoup de cas de l’effet de ciseau entre la baisse des PIB des pays
capitalistes industriels «anciens» et la hausse de ceux de «grands
émergents». La crise a également accéléré la fin de la période
d’hégémonie mondiale des Etats-Unis, hégémonie économique, financière et
monétaire depuis les années 1930, hégémonie militaire sans partage à
partir de 1992. Pour autant la Chine n’est en aucune façon en mesure de
prendre le relais des Etats-Unis comme puissance hégémonique.
La nouveauté de l’enjeu politique majeur de la période
Dans cet article, il s’agit de rappeler la racine et la nature des
crises capitalistes qui sont rendues particulièrement saillantes dans
la crise en cours et de situer cette dernière dans «l’histoire longue».
La crise en cours a éclaté au terme d’une très longue phase
(plus
de cinquante ans) d’accumulation presque ininterrompue, la seule phase
de cette durée de toute l’histoire du capitalisme. Elle peut s’étendre
sur des années, voire une décennie entière car elle a comme substrat
une suraccumulation de capacités de production particulièrement élevée
et comme excroissance une accumulation de capital fictif d’un montant
lui aussi sans précédent. De son côté, la situation très difficile des
travailleurs partout dans le monde, aussi différenciée qu’elle soit
d’un continent et même d’un pays à l’autre de par leurs trajectoires
historiques antérieures, résulte de la position de force que le capital a
acquise grâce à la mondialisation de l’armée industrielle de réserve
née de l’extension à la Chine de la libéralisation des échanges et de
l’investissement direct.
S’il n’y a pas de «sortie de crise» pour le capital dans un horizon de
temps prévisible, de façon complémentaire et antagonique l’avenir des
travailleurs et des jeunes dépend très largement, sinon entièrement, de
leur capacité à s’ouvrir des espaces et des «temps de respiration»
politiques propres, à partir de dynamiques dont désormais eux seuls
peuvent être le moteur. On est dans une situation mondiale où ce qui
est devenu décisif est la capacité qu’auront des mouvements, nés sans
se faire annoncer, de s’organiser de façon à entretenir une dynamique
«d’auto-alimentation» et cela même en l’absence de débouché politique
clair ou défini à court terme. C’est cela qui s’exprime en Tunisie, en
Grèce, en Egypte; mais aussi aux Etats-Unis avec le mouvement Occupy
Wall Street, dans le contexte national particulier de la première
puissance capitaliste du monde et d’un espace géographique continental.
Ce que les militants politiques peuvent faire de plus utile est
d’aider ceux qui en sont les acteurs à affronter les obstacles, divers
et nombreux, auxquels les mouvements ayant cette potentialité se
heurtent, et d’y défendre l’idée qu’en dernier ressort les questions
cruciales sont: «qui contrôle la production sociale, dans quel but,
selon quelles priorités et comment ce contrôle social peut-il être
construit politiquement?». Tel pourrait être le sens des termes
processus et mots d’ordre «transitoires» aujourd’hui. Certains me
diront qu’il en a toujours été ainsi. Pour un très grand nombre de
militants, dite dans les termes qui viennent d’être utilisés, une telle
appréciation est largement, sinon complètement, nouvelle.
La valorisation «sans fin et sans limites» du capital comme moteur de l’accumulation
Avant de revenir à la crise commencée en 2007, il faut expliciter les
ressorts de l’accumulation capitaliste. Arrêtons-nous un instant sur la
théorie de l’accumulation en longue période. Sa fonction est d’aider, à
partir d’une compréhension précise des ressorts du mouvement de la
production capitaliste, à expliciter la nature des crises et à situer
chaque grande crise dans l’histoire sociale et politique mondiale. Comme
l’écrit Paul Mattick, en commentant une remarque d’Engels, «
chaque crise concrète ne se comprend que dans le rapport qu’elle entretient avec le développement de la société globale»
[3]. L’ampleur et les traits spécifiques des grandes crises résultent
des moyens auxquels le capital, entendu comme incluant les
gouvernements des plus importants pays capitalistes, aura recouru dans
la période précédente, pour «
dépasser les limites qui lui sont immanentes» avant de voir «
les mêmes barrières se dresser devant lui à une échelle encore plus imposante».
Les crises éclatent au moment où le capital est de nouveau «rattrapé»
par ses contradictions, confrontées aux barrières qu’il se crée à
lui-même. Plus ces moyens auront été importants, plus aura été longue la
période au cours de laquelle des moyens de dépassement auront atteint
leur objectif, plus la révélation de la suraccumulation aura été
différée, plus la crise sera importante et plus sera longue et difficile
la recherche de nouveaux moyens pour «
dépasser les limites immanentes». C’est de cette façon que l’histoire envahit la théorie des crises.
Chaque génération lit et relit Marx. Elle le fait aussi bien pour
suivre l’évolution historique que pour tenir compte de l’expérience
d’impasses théoriques auxquelles elle s’est heurtée. Pendant de
nombreuses décennies, la problématique du développement des forces
productives dans ses différentes variantes a dominé, avec les
réminiscences des théories du progrès qu’elle pouvait encore charrier.
Aujourd’hui, le Marx qu’il faut relire en militant-chercheur est celui
qui aide à comprendre ce que signifie la prise de pouvoir de la finance
A – l’argent dans sa brutalité –, celui qui écrit dans les
Manuscrits de 1857-58 que «
le capital en
tant qu’il représente la forme universelle de la richesse – l’argent
–, est la tendance sans borne et sans mesure de dépasser sa propre
limite» [4]. Ou encore dans le
Capital que la «
circulation
de l’argent comme capital possède son but en elle-même; car ce n’est
que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se
faire valoir. Le mouvement du capital n’a donc pas de limite.» [5]
Au
cours du XXe siècle le capital a démontré, plus encore qu’au moment où
Marx l’étudiait, un degré profond d’indifférence quant à l’usage
social des marchandises produites ou de la finalité des
investissements.
Depuis trente ans, la «
richesse abstraite» a pris toujours
plus la forme de masses de capital-argent en quête de valorisation,
placées entre les mains d’institutions – grandes banques, sociétés
d’assurance, fonds de pension et hedge funds – dont le «métier» est de
valoriser leurs avoirs de façon purement financière, sans quitter la
sphère des marchés de titres et d’actifs fictifs «dérivés» de titres,
sans passer par la production. Alors que les actions et les titres de
dette – publique, d’entreprises ou de ménages – ne sont que des
«à-valoir», des droits à s’approprier une partie de la valeur et de la
plus-value, des concentrations immenses de capital-argent empruntent le
«
cycle raccourci A-A’» qui représente l’expression suprême de
ce que Marx nomme le fétichisme de l’argent. Exprimée par des formes
d’argent de plus en plus abstraites, fictives, «notionnelles» (terme
utilisé par les économistes de la finance), l’indifférence aux
conséquences de la valorisation sans fin et sans limites du capital
imprègne l’économie et la politique, même en «temps de paix».
Les traits majeurs du capital-porteur d’intérêt soulignés par Marx – «
extériorité à la production» et conviction que
«l’intérêt représente le fruit proprement dit du capital, la chose
première, le profit d’entreprise apparaissant comme un simple accessoire
et additif qui s’ajoute au cours du procès de reproduction» –
mettent les dirigeants capitalistes face à la société tout entière, la
répartition (le 1% face aux 99% d’OWS) étant seulement l’expression la
plus facilement saisissable de processus bien plus profonds. Au sommet
des grands groupes financiers, ceux dits «à dominante industrielle» au
même titre que tous les autres, il y a fusion quasi complète entre le
«capital-propriété» et le «capital-fonction» identifiés par Marx pour
les opposer en partie. «L’ère des managers» a cédé la place à une
nouvelle ère où il y a une identité de vues à peu près complète entre
les actionnaires et les dirigeants. Pour un capital où la finance est
aux postes de commande, la poursuite de la valorisation «
sans fin et sans limite»
doit être menée d’autant plus impitoyablement que le système est en
crise. Les «à-valoir» sur la production, dont l’appropriation sous forme
de dividendes ou d’intérêts est menacée, atteignent des montants qui
n’ont jamais été aussi élevés depuis les années 1920. C’est pourquoi,
qu’il s’agisse des travailleurs que le capital parvient encore à
employer étant donné la situation de surproduction, des ressources de
base qui se raréfient ou encore du positionnement face au changement
climatique et à ses conséquences prévisibles, le réflexe qui l’emporte
au sein du capital pris dans son ensemble est l’exploitation des «
deux sources d’où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur»
[6] et cela sans limites, jusqu’à épuisement, quelles qu’en soient les
conséquences. Dans cet article, il n’est pas possible d’étendre
l’analyse aux questions écologiques et à leur interaction avec le
mouvement de l’accumulation et ses contradictions. La crise a rendu les
interactions plus étroites encore, ainsi que le dernier rapport de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le montre [7].
Centralisation et concentration du capital et intensification de la concurrence intercapitaliste
L’idée associée à l’expression les «maîtres du monde», celle d’une
société planétaire à la Métropolis de Fritz Lang, vient d’être
confortée par la publication de trois chercheurs du Department of
Management, Technology and Economics (D-MTEC) de l’ETHZ de Zurich d’une
étude statistique et mathématique («The Network of Global Corporate
Control») très poussée sur les interconnexions financières entre les
plus grandes banques et entreprises transnationales [8]. Un autre
article serait nécessaire pour examiner la méthodologie, les données de
base et les conclusions de cette étude. Celle-ci est ambitieuse, les
implications de ses résultats sont importantes, mais ces résultats
exigent d’être croisés avec d’autres faits. Quel sens donner au
classement de cinq groupes financiers français (dont Axa au 4e rang et
la Société Générale au 24e) dans les cinquante premiers groupes
mondiaux rangés par le nombre de leurs liens, caractérisés comme étant
de «contrôle» sur d’autres banques et entreprises? Comment réconcilier
cette information avec l’obligation de leur venir en sauvetage? La
densité des interconnexions financières ne traduit-elle pas surtout des
flux d’opérations financières dont les groupes en question sont les
intermédiaires, ceux avec le plus grand nombre de liens n’ayant que le
statut de nœuds dans le système, et pas celui de centralisateurs de
valeur et de plus-value [9]?
La publicité donnée à cette étude exige de faire deux séries
d’observations théoriques, qui sont au demeurant indispensables à la
compréhension de la situation mondiale. Les processus de libéralisation
et de privatisation ont fortement renforcé les mécanismes de
centralisation et de concentration du capital, tant au plan national
que de façon transnationale. Ces processus ont concerné le «Sud» autant
que le «Nord». Dans des secteurs donnés des pays dits «émergents» –
la banque et les services financiers, l’agro-industrie, les mines et
les métaux de base –, on a vu la centralisation et la concentration du
capital et son expansion vers les pays voisins. Au Brésil et en
Argentine par exemple, la formation d’oligarchies «modernes» puissantes
est allée de pair avec de forts processus endogènes d’accumulation
financiarisée et la mise en valeur «d’avantages comparatifs» conformes
aux besoins en matières premières de cette accumulation mondiale, dont
la Chine est devenue le pivot. Des oligopoles rivalisant avec leurs
semblables nord-américains ou australiens dans l’extraction et la
transformation des métaux et l’agro-industrie s’y sont constitués, en
particulier au Brésil. Du fait de la mondialisation, les
interconnexions entre les banques et entre celles-ci et les entreprises
engagées dans la production industrielle et les services sont devenues
plus fortement transnationales qu’elles ne l’ont jamais été. Le champ
d’action de ce que Lénine nommait «l’entrelacement» est celui de
l’économie mondiale. Le capitalisme n’est pas monolithique pour autant.
L’entrelacement n’efface pas la concurrence entre les oligopoles qui
ont retrouvé à l’occasion de la crise des traits nationaux et des
comportements peu coopératifs. Ce qui prévaut aujourd’hui dans l’arène
mondiale est ce que Marx nomme
«l’anarchie de la production»,
dont l’aiguillon est la concurrence, même si le monopole et l’oligopole
sont la forme absolument dominante des «capitaux nombreux» qui
déclinent le capital pris comme totalité. Les Etats, ou plus exactement
certains Etats, ceux qui en ont encore les moyens, sont de plus en plus
les agents actifs de cette concurrence. Le seul qui en garde les
moyens en Europe continentale est l’Allemagne. Ce n’est pas le cas de
la France où la bourgeoisie s’est faite de nouveau financière et
rentière, a laissé un processus de désindustrialisation se faire, s’est
enfermée dans le choix énergétique du nucléaire et voit désormais ses
«champions nationaux» sombrer les uns après les autres. D’où les
interrogations sur le sens de la présence des banques françaises dans
les cinquante «maîtres du monde».
L’autre remarque majeure concernant la centralisation-concentration du
capital nous ramène à notre fil conducteur. La raison pour laquelle les
lois coercitives de la concurrence défont les tendances allant dans le
sens de l’entente entre les oligopoles mondiaux est que le capital,
aussi centralisé qu’il soit, n’a pas le pouvoir de se libérer pour
autant des contradictions qui lui sont consubstantielles, pas plus
qu’il ne peut bloquer le moment où il se retrouve face à ses «
limites immanentes».
Le capital «rattrapé» par les méthodes choisies depuis quarante ans pour surmonter les barrières immanentes
La crise commencée en août 2007 survient donc au terme d’une très longue phase
(plus
de cinquante ans) d’accumulation presque ininterrompue. Les
bourgeoisies ont tiré pleinement parti de la politique mise en œuvre à
partir de l’URSS et plus tard de la Chine (en Indonésie notamment entre
1960 et 1965) pour contenir la révolution sociale anticapitaliste et
anti-impérialiste partout où elle est apparue et pour briser le
mouvement révolutionnaire antibureaucratique depuis Berlin en 1953 et
Budapest en 1956 jusqu’à Tiananmen en 1989. Le capital – les
gouvernements des principaux pays capitalistes dans des rapports
changeants avec les foyers privés de centralisation du capital et de
pouvoir de la finance et de la grande industrie – a pu trouver à partir
de 1978-1980 des réponses aux barrières résultant de ses contradictions
internes. En 1973-75, la période dite des «trente glorieuses» – dont
le fondement, on ne le dira jamais assez, a été l’immense destruction
de capital productif et de moyens de transport et de communication
provoquée par l’effet successif de la crise des années 1930 et de la
Seconde Guerre mondiale – a pris fin avec la récession. Le capital s’est
trouvé de nouveau confronté à ses contradictions internes, sous la
forme de ce que certains ont nommé la «crise structurelle du
capitalisme».
Trois réponses successives – qui se sont non pas substituées mais
ajoutées les unes aux autres – ont permis au capital de prolonger
l’accumulation de plus de trente ans. C’est d’abord, après une dernière
tentative de «relance keynésienne» en 1975-77, l’adoption à partir de
1978 des politiques néoconservatrices de libéralisation et de
déréglementation dont la mondialisation du capital est issue. La
«troisième révolution industrielle» des technologies de l’information et
de la communication y est étroitement associée. Même si les TIC ont
été un facteur qui a contribué à en assurer le succès, cette réponse a
été avant tout politique. Elle a reposé sur ce socle
idéologico-théorique très fort construit par Friedrich Hayek et Milton
Friedman [10]. Puis, à partir de la première moitié des années 1990, la
seconde réponse a été la mise en place de ce «régime de croissance»
décrit plus haut, dans lequel l’endettement privé et, dans une moindre
mesure, l’endettement public sont devenus le soutien central à
l’accumulation. La troisième réponse a été l’incorporation par étapes
de la Chine dans les mécanismes de l’accumulation mondiale, l’entrée de
celle-ci à l’OMC en étant le couronnement.
En prenant l’idée que le capital voit «
les mêmes barrières se
dresser devant lui à une échelle encore plus imposante»
comme fil conducteur, c’est en partant de ces trois séries de facteurs
que l’ampleur et la durée probable de la grande crise commencée en
août 2007 peuvent être appréciées.
La suraccumulation comme substrat fondamental de la crise
La longueur exceptionnelle de la phase d’accumulation – qui a connu des
moments de ralentissement et un nombre croissant d’avertissements
(dont la crise asiatique de 1988 en particulier), mais qui n’a pas
connu de vraie césure – et l’intégration en fin de période de la Chine
dans le marché mondial font de la suraccumulation la plus importante
barrière que le capital retrouve de nouveau devant lui. Au-delà des
traits spécifiques de chaque grande crise, la suraccumulation du
capital en est la raison première. La soif insatiable de plus-value du
capital et le fait que le capital «
veut qu’on produise
exclusivement pour lui, alors que les moyens de production devraient
servir à une extension continue de la vie sociale» [11] expliquent
que les crises sont toujours fondamentalement des crises de
suraccumulation de capacités de production, dont le corollaire est la
surproduction de marchandises. Cette suraccumulation et cette
surproduction sont «relatives» [12], le point de référence étant le
taux de profit minimum auquel les capitalistes continuent d’investir et
de produire. L’ampleur de la suraccumulation aujourd’hui tient à ce
que les conditions spécifiques qui ont conduit à la crise et qui la
prolongent,ont pendant longtemps masqué le mouvement sous-jacent de
baisse du profit. Il s’agit de bien autre chose que de l’euphorie
classique des booms de fin de cycle. Moins encore de faits imputables
aux traders. Il y a eu, cas dans le cas des Etats-Unis et des pays de
l’UE, une désactivation par l’endettement toujours élevé permis par les
«innovations financières» des mécanismes d’avertissement. Dans le cas
de la Chine, ce sont des raisons politiques qui interdisent à la baisse
du taux de profit, tout à fait identifiable, de venir freiner
l’accumulation de capacités productives nouvelles, moins encore de la
stopper.
Dans chaque grande crise, la suraccumulation de capacités de production
et la surproduction de marchandises sont celles de secteurs et
d’industries spécifiques. La crise provoque ensuite par contagion un
état de surproduction dans d’autres industries et secteurs. Le niveau
d’analyse pertinent est sectoriel et souvent national. A partir du
moment où la crise financière a commencé, en 2007 et 2008, à mettre à
mal les mécanismes d’endettement et à provoquer la contraction du
crédit (le «
credit crunch»), certains secteurs (l’immobilier
et le bâtiment aux Etats-Unis, en Irlande, en Espagne, au Royaume-Uni)
et certaines industries (l’automobile aux Etats-Unis et dans tous les
pays constructeurs en Europe) se sont révélés être en très forte
surcapacité. Aujourd’hui encore, on y trouve des stocks de logements et
de bureaux ni vendus, ni même loués. Dans les industries électriques
et mécaniques, les surcapacités des rivaux oligopolistiques les plus
faibles (Renault, Peugeot, Fiat, Goodyear) et de leurs fournisseurs,
elles, ont été résorbées par la fermeture de sites et la destruction ou
la délocalisation des machines. Les surcapacités mondiales restent
intactes.
Fin 2008 et en 2009, il y a eu u

ne
destruction de «capital physique», de capacités de production en
Europe et aux Etats-Unis. Ses effets d’assainissement en vue d’une
«reprise» ont été contrecarrés par la poursuite de l’accumulation en
Chine. De 2000 à 2010, la croissance de l’investissement fixe brut
chinois a été en moyenne de 13,3% par an, faisant en sorte que la part
de l’investissement fixe dans le PIB a grimpé de 34% à 46% (voir
graphique «Evolution de la part des composantes du PIB chinois»,
source: Lettre n° 75, juin 2010, de la Direction générale du Trésor,
Ministère de l’économie, France). Cette expansion de l’investissement
est moins le fait de la hausse des dépenses gouvernementales dont les
autres membres du G20 se sont félicités en 2009, que le résultat de
mécanismes profonds qui révèlent des processus incontrôlés, voire d’une
véritable fuite en avant. Les premiers concernent la concurrence
acharnée que les provinces et les grandes municipalités se font pour
investir dans les industries manufacturières et dans la construction
[13]. Il en va du prestige, mais aussi des revenus occultes des pans de
la «bureaucratie-bourgeoisie» chinoise. Les ministères à Pékin
reconnaissent l’existence de surcapacités très importantes dans les
industries lourdes [14]. Pourquoi alors ne pas intervenir? Parce que
les rapports politiques et sociaux propres à la Chine ont enfermé le
PCC dans l’étau de la situation suivante. Comme condition d’une paix
sociale minimale (voir les grèves qui se multiplient), la direction du
PCC a promis au peuple «la croissance». Il a même calculé un taux de
croissance de 7-8% comme étant le minimum compatible avec la stabilité
politique. Mais la croissance ne peut pas reposer sur la consommation
de la majorité de la population. Le PCC ne peut ni concéder aux
travailleurs les conditions politiques leur permettant de se battre
pour des hausses de salaires, ni instaurer des services publics (la
santé, l’éducation universitaire, l’assurance vieillesse), puisque,
dans la trajectoire politique chinoise dont Tienanmen a été le jalon
majeur, cela serait interprété comme un signe d’affaiblissement de son
emprise politique. Les 7 à 8% de taux de croissance ont donc été
obtenus par une expansion démentielle du seul secteur des biens
d’investissement (le secteur I dans les schémas de la reproduction
élargie). La chute entre 2000 et 2010 de la part de la consommation
privée dans le PIB, de 46% à 34%, donne une dimension de l’impasse que
le PCC s’est créée. L’excédent commercial de la Chine est «seulement»
de 5 à 7% du PIB, mais ses ventes représentent presque 10% des
exportations mondiales. Les exportations sont la soupape de la
suraccumulation chinoise, le canal par lequel celle-ci crée un effet
dépressif sur tous les pays qui subissent la concurrence des produits
chinois. Cet effet dépressif provoque un effet en retour de sorte que la
Chine connaît depuis l’été une baisse de ses exportations. La
destruction de capacités de production dans l’industrie manufacturière
de nombreux pays dont on parle peu (textile au Maroc, en Egypte et en
Tunisie par exemple), mais aussi dans d’autres dont on parle davantage
et où elle a été la contrepartie de l’exportation de produits résultant
des filières technologiques des métaux ferreux et non-ferreux et de
l’agro-industrie (cas du Brésil), exprime le poids que la surproduction
chinoise fait peser le marché mondial comme un tout.
Poids écrasant du capital fictif et pouvoir presque inentamé des banques
On en vient à la finance et au capital fictif, dont il a été souvent
question dans mes articles depuis 2007, ainsi que dans mon ouvrage
Les dettes illégitimes (voir sur ce site
«Les dettes illégitimes quand les banques font main basse sur les politiques publiques»).
En
effet, le second trait spécifique de la crise actuelle est d’avoir
éclaté au terme d’au moins vingt ans de recours à l’endettement comme
forme majeure de soutien de la demande dans les pays de l’OCDE. Ce
processus a comporté une création extraordinairement élevée de titres
ayant le caractère d’«à-valoir» sur la production actuelle et à venir.
Ces «à-valoir» ont eu un fondement de plus en plus étroit. A côté des
dividendes sur les actions et des intérêts sur des prêts aux Etats, on a
vu la croissance du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire
qui sont des ponctions directes sur les salaires. Le poids du capital
s’exerce sur les salariés à la fois sur leur lieu de travail et comme
débiteur auprès des banques. Ce sont donc des «à-valoir» de plus en
fragiles qui ont servi de base pour une accumulation (ce mot est utilisé
faute de mieux) d’actifs «fictifs au énième degré». La crise des
crédits hypothécaires
subprime en a momentanément détruit une
petite partie. Mais même les banques centrales n’en connaissent pas
vraiment le montant astronomique, ni les circuits et les détenteurs
exacts en raison du système financier de l’ombre
(shadow banking system).
On ne dispose que d’estimations assez vagues. Ce qu’on a nommé la
financiarisation a été la plongée quasi structurelle dans une situation
décrite par Marx dans un passage peu commenté du premier chapitre du
livre II du
Capital. Il y note qu’aussi bizarre qui cela puisse paraître en plein triomphe du capital industriel, «
le procès de production capitaliste apparaît seulement comme un mal nécessaire pour faire de l’argent», de sorte que «
toutes
les nations adonnées au mode de production capitaliste sont prises
périodiquement du vertige de vouloir faire de l’argent sans
l’intermédiaire du procès de production». A partir des années 1980,
dans les pays capitalistes centraux, Etats-Unis en tête, le «vertige» a
commencé à prendre un caractère structurel. La finance a donné à ce
vertige, fruit du fétichisme de l’argent, des assises
politico-institutionnelles très fortes. Il est parvenu à faire reposer
le «pouvoir de la finance» et les croyances fétiches qu’il charrie sur
un degré de mondialisation, notamment financière, inédite dans
l’histoire du capitalisme.
La clef de voûte de ce pouvoir est la dette publique des pays de
l’OCDE. En un premier temps, dès les années1980, le service de la dette
a opéré à partir des impôts un immense transfert de valeur et de
plus-value vers les fonds de placement et les banques, par le canal de
la dette du tiers-monde bien sûr, mais à une échelle bien plus élevée
par le canal de la dette des pays capitalistes avancés. Ce transfert
est l’une des causes de la modification profonde dans la répartition du
revenu entre le capital et le travail. Plus le capital a renforcé son
pouvoir social et politique, plus les entreprises, les détenteurs de
titres et les patrimoines les plus élevés ont été en mesure d’agir
politiquement pour se libérer du poids de l’impôt. L’obligation pour
les gouvernements de recourir à l’emprunt s’est sans cesse accrue. A
partir du premier gouvernement Clinton, on commence à ne plus avoir
affaire aux Etats-Unis à des politiques monétaires d’accommodement de
la finance, mais à un début de «capture de l’Etat» par les grandes
banques [15]. La nomination de Robert Rubin, président de Goldman
Sachs, a représenté un moment de cette capture. La crise de septembre
2008, avec Henry Paulson aux manettes de commande, a parachevé le
processus. Elle a ouvert la phase actuelle qui est marquée par la
contradiction centrale suivante, propre au soutien de la croissance sur
une période aussi longue. On en prendra conscience de façon toujours
plus aiguë dans les mois qui viennent! Les «marchés», c’est-à-dire les
banques et les investisseurs financiers, dictent la conduite des
gouvernements occidentaux, l’axe étant, comme on le voit si clairement
en Grèce, la défense des intérêts économiques et politiques des
créanciers quelles qu’en soient les conséquences en termes de
souffrance sociale. Mais en raison du montant et des conditions
d’accumulation des actifs fictifs, une crise financière majeure peut se
déchaîner à tout moment sans que ni le moment ni le point de rupture
du système financier puissent être prévus.
Les raisons dépassent celles propres aux opérations des banques sur
lesquelles l’accent est mis le plus souvent: nature des actifs fictifs;
épuration très incomplète des actifs toxiques de 2007, notamment pas
les banques européennes; dimension de ce qui est nommé «l’effet de
levier» [16], etc. Le capital souffre d’un manque aigu de plus-value
que la surexploitation des travailleurs employés, grâce à l’armée
industrielle de réserve, ainsi que le pillage des ressources de la
planète compensent de moins en moins. Si la masse du capital engagé
dans l’extraction de plus-value stagne ou se contracte, il arrive un
moment où aucun accroissement du taux d’exploitation ne peut en
contrecarrer les effets. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir des
banques est presque inentamé et qu’il existe plus que jamais une masse,
très importante et très vulnérable, d’«à-valoir» sur la production
ainsi que de produits dérivés et autres actifs «fictifs au énième
degré»? Sur fond de suraccumulation et de surproduction chroniques, les
conséquences en sont, entre autres, les suivantes.
La première est de donner lieu à des politiques économiques et
monétaires qui poursuivent deux objectifs aux effets contradictoires.
Il faut, par la voie des privatisations, ouvrir au capital des secteurs
protégés socialement, afin de lui offrir des opportunités de profit en
attendant, ou pour mieux dire en espérant, que les conditions
d’ensemble de «sortie de crise» se recréent. Les projets de
privatisation et «d’ouverture à la concurrence» programmés sont donc
mis en œuvre et de nouveaux sont conçus. Mais il faut aussi essayer
d’éviter que se produise un effondrement économique qui verrait
nécessairement la destruction d’une partie du capital fictif, à
commencer par celui ayant la forme de créances, de titres de dette. Or
le caractère pro-cyclique (d’accentuation de la récession) du premier
objectif a pour effet d’en renforcer la possibilité.
Il y a, parallèlement, la contradiction, un peu semblable mais quand
même différente, qui voit les «marchés» imposer des politiques
d’austérité par peur du défaut de paiement et rendre celui-ci de plus
en plus inévitable du seul fait
mécanique de la contraction accentuée de l’activité économique.
L’autre conséquence majeure du pouvoir de la finance et de la capacité
qu’elle a eue de limiter très fortement la destruction du capital
fictif dans les pays de l’OCDE est l’existence de cette masse énorme
d’argent – masse fictive aux effets réels – qui passe continuellement
d’une forme de placement à une autre, créant une instabilité financière
très forte, générant des bulles qui peuvent être autant de
déclencheurs de crise généralisée et aiguisant souvent, dans le cas de
la spéculation sur les produits alimentaires notamment, les conflits
sociaux.
L’extrême faiblesse des outils de politique économique
Le dernier grand trait de la crise est qu’elle a éclaté et s’est
développée alors que les politiques de libéralisation et de
déréglementation étaient venues détruire les conditions géopolitiques et
macrosociales dans lesquelles des instruments anticycliques d’une
certaine efficacité avaient été précédemment mis au point. Pour le
capital les politiques de libéralisation ont leur «bon côté», mais elles
en ont aussi un «mauvais». La libéralisation a mis les travailleurs en
concurrence de pays à pays et de continent à continent comme jamais
auparavant. Elle a ouvert la voie à la déréglementation et aux
privatisations. Les positions du Travail face au Capital ont été très
fortement affaiblies, éliminant jusqu’à présent la «peur des masses»
comme aiguillon de la conduite du capital. L’envers de la médaille est
constitué par cette carence d’instruments anticycliques, aucun substitut
n’ayant été trouvé à ceux du keynésianisme, ainsi que par la rivalité
intense entre les protagonistes majeurs de l’économie capitaliste
mondialisée, dans une phase où la puissance hégémonique en place a perdu
tous les moyens de son hégémonie, à l’exception des moyens militaires
dont elle ne peut utiliser qu’une petite partie et dans ce cas-là pour
l’instant sans grand succès.
Le seul instrument disponible est l’émission de monnaie, la planche à
billets à l’intention des gouvernements (cas des Etats-Unis où la Fed
achète une partie des bons du Trésor), mais surtout au bénéfice des
banques. Ce terrain est aussi le seul où une forme de coopération
internationale fonctionne. L’annonce le 30 novembre 2011 de la création
de liquidités en dollars, d’un commun accord entre banques centrales à
l’initiative de la Fed, pour contrecarrer l’assèchement du
refinancement des banques européennes par leurs homologues étatsuniens,
en est le dernier exemple en date.
Résister et s’engager dans des eaux où on n’a encore jamais navigué
J’ai expliqué comme d’autres [17] la nécessité, incontournable, absolue
de se disposer dans la perspective d’un krach financier majeur pour
saisir les banques. Cet article exige une conclusion plus large. Aucune
«sortie de crise» ne se dessine pour le capital au plan mondial, dans
un horizon de temps prévisible. Pour les grands centres singuliers de
valorisation du capital que sont les groupes industriels européens,
l’heure est à la migration vers des cieux plus cléments, vers les
économies qui combinent un taux d’exploitation élevé et un marché
domestique important. Les conditions de la reproduction sociale des
classes populaires sont menacées. La montée de la pauvreté et la
paupérisation rampante qui touche des couches toujours plus importantes
des salarié·e·s en sont l’expression. Le Royaume-Uni en a été l’un des
laboratoires avant même que la crise n’éclate [18]. Plus celle-ci dure,
plus s’éloignera tout autre avenir pour les salarié·e·s que la
précarité et la baisse du niveau de vie.
Les maîtres mots qui sont martelés sont «adaptation», «sacrifice
nécessaire». De temps en temps, des syndicats peuvent pour maintenir la
plus petite légitimité appeler à des journées d’action. La grève d’un
jour (30 novembre) des agents de l’Etat au Royaume-Uni en est l’exemple
le plus récent. Mais comme je l’ai écrit plus haut, l’avenir des
travailleurs et des jeunes dépend très largement, sinon entièrement, de
leur capacité à s’ouvrir des espaces et des «temps de respiration»
politiques propres, à partir de dynamiques dont désormais eux seuls
peuvent être le moteur. Un autre monde est très certainement possible,
mais il ne peut plus se dessiner que pour autant que l’action ouvre la
voie à la pensée, laquelle, plus que jamais, ne peut être que
collective. C’est un renversement complet avec les périodes où il
existait, au moins en apparence, des plans préétablis de la société
future, que ce soit ceux de certains socialistes utopiques ou du
Komintern de Dimitrov [1882-1949, secrétaire général du Kommintern de
1934 à sa dissolution en 1943].
Les navigateurs anglais ont forgé au XVIe siècle la belle expression «
uncharted waters», des eaux où on n’a encore jamais navigué, pour lesquelles il n’y a aucune carte. C’est notre cas aujourd’hui.
(Début décembre 2011)
____
[1] CNUCED,
L’économie mondiale face aux enjeux politique d’après-crise, Genève, septembre 2011.
[2] Marx,
Manuscrit de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, vol. 1.
[3] Paul Mattick,
Crises et théories des crises, Editions Champ libre, Paris, 1976, pp. 113-114.
[4] Marx,
Manuscrit de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, vol. 1, p. 273.
[5] Marx,
Le Capital, Livre I, tome 1, Editions Sociales, pp. 113-114, 156-157.
[6] Marx,
Le Capital, Livre I, tome 2, Editions Sociales, pp. 181-182.
[7] Voir le très bon article d’Antoine Reverchon, «Quelle est la vraie valeur des réserves d’éngergie fossile?»,
Le Monde Economie, 15 novembre 2011 (valeur boursière ou valeur pour la société humaine).
[8] Stefania Vitali, James B. Glattfelder and Stefano Battiston,
The Network of Global Corporate Control.
[9] Autant de questions qu’il faudait creuser pour voir si l’étude de
l’ETHZ est justiciable d’une problématique relevant du capital financier
de Hilferding et Lénine.
[10] Voir Pierre Dardot et Christian Laval,
La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Editions La Découverte, 2009.
[11] Marx,
Le Capital, Livre III, tome 6, Editions Sociales, p. 263.
[12] Marx soulève l’hypothèse de situations où il y aurait une «suraccumulation absolue» de capital.
Ibid., pp. 234-265.
[13] Voir l’article de Mylène Gaulard, «Les limites de la croissance chinoise», in
Revue Tiers Monde, n° 200, décembre 2009, pp. 875-893.
[14] Le site de l’édition en anglais du quotidien du PCC abonde d’exemples (
http://english.peopledaily.com.cn/).
Il suffit de taper les termes China overcapacity pour les trouver. On
peut consulter aussi l’étude faite pour la Chambre de commerce
européenne:
Overcapacity in China. Causes, Impacs and Recommendations, 2009.
[15] S. Johnson and J. Kwak,
13 Bankers – The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon Books, New York, 2010.
[16] Voir mon livre
Les dettes illégitimes, Raisons d’agir, 2011 et Louis Gil,
La crise financière et monétaire mondiale, M Editeur, Québec, 2011.
[17] A commencer par Frédéric Lordon. Voir son blog
La pompe à phynance sur les blogs du
Diplo et son ouvrage
La crise de trop. Reconstruction d’un monde failli, Fayard, 2009, ainsi que son intervention que l’on trouve aussi sur ce site TV A l’Encontre, sur la
homepage.
[18] Voir l’ouvrage de Owen Jones,
Chavs. The Demonization of the Working Class, Verso Ed, avril 2011.
 Como
en películas de gángsteres, cuando un asesino intenta borrar huellas
del crimen falsificando documentos que lo podrían involucrar, han
procedido personeros del ministerio de Educación chileno con respecto a
ese pasado inmediato del cual muchos de ellos provienen, sino física,
por lo menos ideológicamente.
Como
en películas de gángsteres, cuando un asesino intenta borrar huellas
del crimen falsificando documentos que lo podrían involucrar, han
procedido personeros del ministerio de Educación chileno con respecto a
ese pasado inmediato del cual muchos de ellos provienen, sino física,
por lo menos ideológicamente.